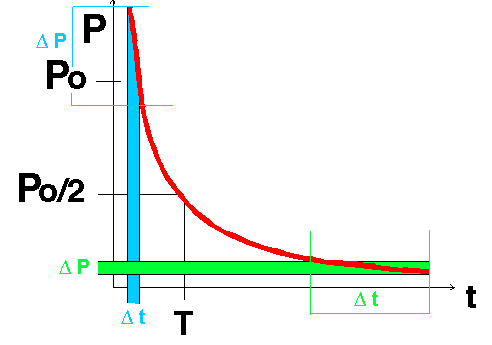Paléoécologie
retour accueil,
concepts (de l'objet à la
méthode / l'actualisme /
les datations / l'évolution
des êtres vivants), formulations-questions-activités
par cycle
1. Concepts
a. de l'objet et de la méthode
Le passé n'est plus. Le passé n'est pas
accessible à l'expérience et donc la
méthode expérimentale ne peut plus s'utiliser. Nous
ne sommes plus dans une science expérimentale. Ce n'est
pas une science historique car l'histoire ne commence qu'avec
l'apparition de l'écriture et des témoignages
humains.
Cette science est la paléontologie (du grec
"paléo": "ancien" et "ontos": "l'être").
Etant donné le rôle fédérateur de
l'écologie actuellement (voir le page - un peu
fouillis - sur l'écosystème),
il est peut-être pertinent de parler de
paléoécologie (toujours du grec
"paléo": passé, "oikos": habitat, et
"logos" : parler) quand on veut désigner les recherches
sur les êtres vivants et leur vie passée.
Le problème central est celui du
temps. Je vous renvoie aux pages d'introduction
sur les questions fondamentales pour un premier contact avec
cette question qui ne sera jamais close. J'essaie de présenter
une petite vision
"bergsonnienne" du problème et quelques réflexions
plus hétéroclites, notamment sur le temps.
|
les
fossiles et la fossilisation
|
|
étymologiquement fossile signifie
"tiré de la terre" (du latin fodio, is, fodi,
fossum = creuser, fouir) et on trouve principalement
deux types de définitions:
* un fossile désigne toute trace ou reste
d'être vivant aujourd'hui disparu; dans ce cas
les "fossiles vivants" sont des exceptions car
ils appartiennent à des êtres vivant
actuellement mais dont les restes peuvent être
très anciens.
* un fossile désigne toute trace ou reste
d'être vivant mort trouvé dans une roche
sédimentaire ; les exceptions sont les organismes
conservés dans l'ambre, qui est une
résine fossile (insectes comme des fourmis datant de
l'ère tertiaire; si vous vous
intéressez à l'ambre voyez le tout nouveau
livre et le site internet d'un spécialiste à
l'adresse http://ambre.jaune.free.fr/
), des rhinocéros momifiés dans les
asphaltes des Carpates, les mammouths congelés
dans les glaces de Sibérie et dont l'estomac
gardait encore «surgelées» les
dernières plantes qu'ils avaient
ingérés.
|
|
La fossilisation désigne l'ensemble des
phénomènes qui conduisent à la
formation d'un fossile ou plus précisément
à la conservation des êtres vivants ou de leurs
traces dans les sédiments puis dans les roches
sédimentaires.
A sa mort le cadavre d'un être vivant est enfoui
progressivement dans le sédiment
(enfouissement).
Le sédiment étant un milieu de vie, la
matière organique du cadavre est habituellement
rapidement et entièrement oxydée par les
microorganismes du sédiment (en H2O, CO2, CH4, NO3-,
SO42-...). Parfois la minéralisation de la
matière organique n'est que partielle et des
hydrocarbures ou des gaz organiques peuvent être
produits lorsque l'accumulation de cadavres est très
importante. Cela donne lieu à la génèse
de kérogène à la base des roches
carbonées (voir sous-sol).
Parfois encore, dans des conditions très
particulières (fortement réductrices ou
à une température très basse) qui
empêchent l'oxydation de la matière organique,
cette dernière peut se dessécher et être
conservée (dans l'ambre, l'alsphate, la glace; on
cite également des fragments de peau momifiés
de quelques Reptiles de l'ère secondaire
(Iguanodon , Anatosaurus et
Ichthyosaurus) ainsi que les micro-organismes
fossilisés dans les silex qui auraient
conservé leur matière organique toujours
susceptible de coloration). Dans des
conditions réductrices et sans vie la matière
organique peut être conservée des dizaines voir
des centaines de millions d'années: par exemple on a
pu retrouver et déterminer les protéines
d'ossements de Dinosauriens de 150 millions d'années
et de Poissons de 250 millions d'années. Des analyses
biochimiques analogues ont permis de découvrir des
traces de chlorophylle dans des roches très anciennes
n'ayant pas conservé le moindre vestige identifiable
de Végétaux, même tout à fait
inférieurs.
Pendant la diagénèse qui affecte
le sédiment incluant le fossile en formation, les
éléments minéraux du cadavre subissent
les mêmes transformations que sa gangue. C'est pour
cela qu'il faut des conditions très
particulières pour que les structures de l'être
vivant soient conservées. Les parties dures (os,
dents, coquilles, squelettes minéralisés d'une
façon générale...) se conservent bien
évidemment le plus facilement, bien qu'elles soient
la plupart du temps recristallisées. La
cristallisation nouvelle peut se faire soit avec le
même minéral: calcite -> calcite; soit avec
un autre minéral: par exemple: calcite -> silice
(silicification) ou calcite -> dolomie (dolomitisation),
hydroxyapatite de l'os (Ca10
(PO4)6 (OH)2) -->
francolite (carbonate de fluoroapatite résultant du
remplacement des ions hydroxyle par le fluor dans
l'hydroxyapatite)... Les parois végétales,
organiques mais fortement indurées par la lignine,
peuvent aussi s'imprégner de silice et conserver
ainsi leur forme (bois silicifiés). Lorsque l'on a
remplacement d'un élément (minéral ou
organique) par un autre, avec conservation plus ou moins
fine de la structure, on parle
d'épigénie, ou d'une façon plus
générale, de métasomatose (si
l'on veut désigner le phénomène de
croissance minérale avec remplacement d'un
minéral par un autre).
L'épigenèse interviendrait en
fait après la diagénèse (du grec
épi = au-dessus et dia = à
travers) mais les phénomènes sont certainement
fortement imbriqués et il est difficile de
reconstituer leur part réciproque dans l'histoire
d'un fossile. Les traces les plus fréquentes
sont les moules internes et externes des coquilles
d'invertébrés: seul le sédiment
remplissant la coquille ou moulant l'extérieur de
celle-ci conserve la trace de l'animal lors de sa
transformation en roche sédimentaire. La forme de la
coquille est alors conservée du fait de l'arrangement
spatial des cristaux de la roche sédimentaire formant
le moule: il n'y a plus aucun élément ni
minéral ni organique appartenant à l'animal
fossilisé. Très rarement on retrouve des
empreintes de parties molles.
Un article: "La fossilisation : une
exception conjoncturelle", Christiane Denys, Pour La
Science, 292, février 2002
|
b. l'actualisme
|
Une formulation de l'
actualisme ou du
...principe des causes
actuelles
|
Les lois
expérimentales
(actuelles, vérifiables, donc toujours soumises
à l'expérience...)
étaient aussi valables par le
passé.
|
Cette formulation n'est certainement ni la seule exacte, ni la
plus historique (si je ne me trompe c'est d'abord le catastrophisme
de Cuvier qui a dominé (révolutions subites) et
a été remplacé par l'uniformitarisme de Lyell et
de Lamarck (théorie du développement continu) pour
finalement déboucher sur cette présentation moderne
d'un principe philosophique plus ancien qui dépasse de
loin la querelle catastrophisme-uniformitarisme), mais elle peut
s'appliquer aisément à notre méthode.
Le principe des causes actuelles nous permet de dire que les
causes de l'évolution sont actuellement décelables
car actuellement en jeu. Je précise : les causes et non
pas forcément les mécanismes, dans le sens
où il peut très bien y avoir eu des étapes dans
l'évolution qui sont passés et ne se reproduiront plus.
Ce sur quoi il est nécessaire de s'accorder c'est sur la
causalité et donc sur la validité des lois
expérimentales par le passé. Les lois
expérimentales découvertes actuellement s'appliquaient
par le passé.
En énonçant ce principe, le scientifique sait qu'il
fait reposer sa connaissance sur un principe raisonnable, mais qui
n'est pas scientifique, dans le sens où il n'est pas
démontrable expérimentalement. Toute discussion de la
validité de ce principe reste dans le cadre d'une discussion
scientifique, mais se fait, non pas avec les outils du scientifique,
mais avec ceux du philosophe.
L'uniformitarisme est une version très
différente, qui stipule que les mécanismes actuels sont
les mêmes que par le passé. Il ne s'agit plus des
causes, mais des phénomènes eux-mêmes, de leur
vitesse... on y oppose le catastrophisme, qui lui
préfère des mécanismes différents.
Aucun de ces deux principes n'est utile pour le géologue
(je veux dire qu'aucun n'est indispensable, et qu'on peut donc les
rejeter comme principes).
Remarque:
cette notion est-elle accessible à un enfant
du primaire ? Je n'ai pas de réponse tranchée,
mais, d'après ma toute jeune expérience, il semblerait
que les enfants ne se posent pas la question. Si l'on ne
sème pas le doute dans leur esprit, il acceptent les lois
actuelles comme éternelles. Faut-il semer ce doute ? Je ne
le pense pas. Mais par contre je crois que tout enseignant doit
connaître les limites de la méthode. Si des questions
sont posées il pourra répondre dans ce sens. Mais
concevoir un enseignement qui irait contre les représentations
pourtant bien souvent peu précautionneuses et peu
nuancées de ceux qui racontent "l'histoire de la vie" ne me
semble pas pertinent . En un sens, que sont ces journalistes (et
parfois certains scientifiques) qui déroulent l'histoire de la
vie comme un conte de fée, si ce n'est des grands enfants ?
Par contre il est clair qu'en lycée il est grand temps de les
aider à se poser ces questions. A mon avis il
n'est jamais trop tôt pour susciter des questions vraies (dans
le sens de la recherche de la vérité) chez un enfant
mais il n'est pas bon de conseiller de généraliser
telle ou telle pratique.
c. les datations
Les principaux éléments de ce
paragraphe sont repris et simplifiés du cours
de TS de
spécialité.
Dans le domaine préhistorique (avant
l'histoire, qui commence avec l'apparition de
l'écriture et donc vers -4000 ans, à -2000 ans selon
les régions, avant Jésus-Christ) ou plutôt
paléontologique, les techniques de datation sont
souvent qualifiées un peu rapidement soit d'absolues soit de
relatives. Je leur préfère les termes de datation
expérimentale et de datation logique : en voici les
raisons.
- Datations expérimentales
les datations expérimentales sont faites sur
des objets matériels (minéral, roche,
inclusion fluide...) et les résultats sont fournis avec
une incertitude.
La méthode la plus employée est la datation
isotopique mais il existe d'autres méthodes comme la
thermoluminescence, l'utilisation de la spectroscopie
infrarouge....
|
Datation isotopique
|
|
On utilise des couple d'isotopes (l'un instable et
l'autre stable) et des isotopes stables de
référence. Un élément
isotopique père instable (radiogène) se
transforme en un élément fils stable
(radiogénique) par émission de particules
alpha (noyaux d'He), bêta (électrons) ou
gamma (photons), selon une loi de
désintégration qui est fonction du temps.
Sa formule générale est
dN/dt = N l
où dN est le nombre d'atomes qui se
désintègrent par radioactivité,
dt est l'intervalle de temps
considéré et l
est la constante de désintégration propre
à chaque élément radioactif. On peut
extraire t qui est donné par la formule: t =
1/l ln[No/N]
où No est la quantité initiale de
l'élément N radioactif au moment de la
fermeture du système.
Cette loi est expérimentale, établie
à partir d'échantillons actuels est
supposée valable par le passé
(l'actualisme est donc un premier
postulat).
On a donc un deuxième postulat: le
système ne s'est pas réouvert depuis sa
fermeture. En d'autres termes, la disparition de
l'isotope père ne se fait que par
radioactivité. Ce postulat devrait toujours
être précisé quand on s'adresse
à des élèves.
On utilise habituellement la période T (ou
demi-vie) qui est le temps nécessaire pour que la
moitié de la masse initiale de
l'élément père ait disparu (T =
1/l ln2).
L'incertitude dépend d'une part de
l'élément considéré et de sa
constante radioactive (certains isotopes sont
adaptés à la mesure d'objets très
anciens (238U par exemple), d'autres
très récents (14C par exemple)).
Voici un tableau qui donne quelques périodes pour
quelques couples (in Géologie, objets et
méthodes, J.Dercourt et J.Paquet, Dunod,
1992):
|
Éléments
radiogènes
|
Éléments
radiogéniques
|
Type de radioactivité
|
Période (T) en
années
|
|
238U
|
206Pb
|
alpha
|
4,468.109
|
|
235U
|
207Pb
|
alpha
|
0,704.109
|
|
232Th
|
208Pb
|
alpha
|
14,01.109
|
|
40K
|
40Ar +
40Ca
|
gamma
|
1,25.109
|
|
87Rb
|
87Sr
|
beta
|
48,8.109
|
|
14C
|
14N
|
beta
|
5,568.103
|
|
147Sm
|
143Nd
|
alpha
|
1,06.1011
|
Représentation graphique schématique d'un
loi théorique de désintégration
radioactive
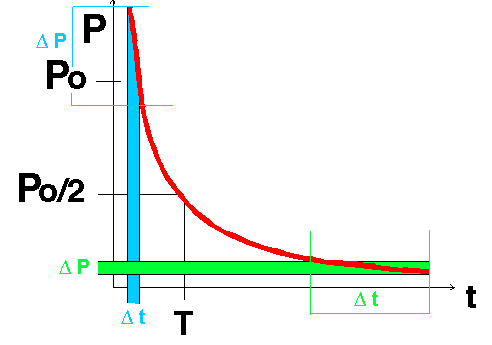
Le domaine bleu est un
domaine où une erreur de concentration n'a que peu
d'incidence sur la valeur de t estimée,
alors que le domaine vert
est un domaine où la valeur de t est
très incertaine, la moindre erreur sur la
détermination de N provoquant une erreur
très importante sur l'estimation de t.
L'incertitude dépend d'autre part de la
quantité d'élément radioactif dans
l'objet analysé: la mesure de concentration se
fait à l'aide d'un spectromètre de
masse. L'incertitude de cette mesure est d'autant
plus faible que la teneur en élément est
grande. Pour une description de la méthode voir
par exemple Géologie, objets et méthodes,
J.Dercourt et J.Paquet, Dunod, 1992, p 31-32. Il est
à déplorer qu'aucune incertitude ne soit
donnée, ici encore.
|
Si l'exposé des techniques de datation expérimentale
est évidemment inadapté au primaire, il est certain
par contre que si l'on donne une datation
elle doit être accompagnée d'une ou
plutôt de deux incertitudes dont voici un
exemple de formulation:
|
Des géologues ont daté un petit morceau
de granite de 180 millions d'années grâce
à des techniques très complexes et
chères (on mesure des quantités
extrêmement petites d'éléments
très lourds et très rares comme le plomb ou
l'uranium présents dans la roche ou dans de toutes
petites des bulles de gaz ou de liquides
piégées dans la roche lors de sa
solidification à partir du magma: ces
éléments se décomposent l'un dans
l'autre au cours du temps: par exemple l'uranium se
transforme petit à petit en plomb). Mais cet
âge qui dépasse l'imagination est
donné avec deux incertitudes*:
c'est-à-dire deux
conditions qu'il faut
connaître pour comprendre la valeur incertaine de
ce chiffre: d'abord il y a une incertitude
liée à la mesure parce que les
quantités sont tellement petites que l'on peut se
tromper (un peu): pour ce granite elle est de 10 millions
d'années (ce qui veut dire que l'on pense que
l'âge du granite est compris entre 190 millions
d'années et 170 millions d'années) ;
ensuite il y a une autre incertitude qui est une
condition beaucoup plus gênante car elle fait que
l'on peut se tromper complètement sur l'âge
qui n'est peut-être pas de 180 millions
d'années mais 500 millions d'années comme 1
million d'années, c'est pourquoi on l'appelle
une incertitude absolue: celle-ci est due au fait
que si l'on trouve très peu
d'éléments que l'on cherche à
trouver dans la roche (plomb par exemple), ce
peut-être non pas parce que la roche est
très jeune (très peu d'uranium s'est
transformé en plomb) mais parce que le plomb s'est
échappé de la roche pour une cause ou une
autre. C'est donc pour cela que les géologues sont
toujours très prudents et savent bien que les
âges qu'ils donnent ne sont vrais que si cette
condition est remplie, ce qui n'est jamais sûr.
* une incertitude en science
expérimentale exprime par un chiffre les limites
dans lesquelles une mesure peut varier sans changer de
valeur ("valeur "au sens non pas de "valeur absolue" mais
au sens de "signification naturelle"); l'incertitude
dépend de l'outil qui sert à mesurer. Par
exemple si je mesure ma taille avec un double
décimètre je ne vais pas forcément
trouver la même valeur que si je me mesure avec un
double-mètre ou avec une toise. Si l'on peut
considérer que ma taille est fixe, présente
une valeur finie, il est certain cependant que,
même avec un gigantesque pied à coulisse
où même avec un système très
complexe de faisceau laser, la mesure de ma taille ne
pourra jamais être faite avec une précision
supérieure à environ 1 mm : il suffit que
je me tienne plus ou moins droit pour que ma taille
change un peu. De la même façon, dans les
objets naturels, les mesures ne sont jamais absolues
(reproductibles sans aucune varaition) et il faut donc
leur attacher une incertitude.
|
- Datation logique ou
datation relative Cette
méthode consiste à comparer logiquement des objets
(matériels ou formels) entre eux et en déduire des
relations relatives à leur chronologie. Comme toute
datation, elle repose sur l'actualisme. Les principes logiques les
plus utilisés sont:
* le principe de superposition (stratigraphique): Une
couche sédimentaire est plus récente que celle
qu'elle recouvre; qui peut être
généralisé en un "principe de
recouvrement" : Une structure (couche sédimentaire
ou volcanosédimentaire ou coulée volcanique...) qui
en recouvre une autre est postérieure à cette
dernière.
* le principe de continuité (stratigraphique):
Une couche sédimentaire limitée par un plancher
(à la base) et par un toit (au sommet) et définie
par un faciès donné (ensemble des conditions de
dépôt du sédiment ayant donné naissance
à la roche) est de même âge en tous ses
points; qui peut être généralisé en
un "principe d'extension": Deux structures voisines
(couches sédimentaires ou volcanosédimentaires ou
coulées volcaniques...) présentant les mêmes
caractères lithologiques et/ou biologiques (faciès
lithologique et biologique) sont de même âge et
formaient par le passé une structure continue.
* le principe d'identité paléontologique:
Deux couches ou deux séries de couches
sédimentaires de même contenu paléontologique
en fossiles stratigraphiques (fossiles caractérisés
par une extension géographique maximale et une extension
chronologique minimale) ont le même âge.
* le principe de recoupement: Toute structure qui en
recoupe une autre est postérieure à cette
dernière.
* le principe d'inclusion: Toute structure incluse dans
une autre lui est antérieure.
Ces techniques de datation expérimentale et logique ont
permis d'établir une échelle des temps
géologiques ou échelle biostratigraphique,
qui tient compte du maximum de résultats obtenus par toutes
les méthodes accessibles. Elle est en incessant remaniement,
du moins dans le détail des subdivisions temporelles.
d. l'évolution des êtres
vivants sur la terre
Pour tous les étudiants
intéressés, je vous invite à vous plonger dans
le
cours de TS, qui
présente bien d'autres ouvertures sur cette
question.
En ce début de XXIème siècle:
L'évolution (évolution biologique) c'est
l'histoire des êtres vivants sur la terre. De nombreuses
théories proposent des explications à l'aide de
diverses philosophies (notamment à la lumière de
l'épistémologie moderne), de la paléontologie
(science historique), de la génétique des populations,
de la biochimie.
Du point de vue de l'histoire des sciences,
l'évolution, comme elle est comprise de nos jours, est en fait
le transformisme (théorie selon laquelle les
êtres vivants dérivent les uns des autres au cours des
temps géologiques par une série de transformations) qui
s'oppose au fixisme (les organismes vivants ne se transforment
pas et ne dérivent pas les uns des autres - cette doctrine
n'étant plus acceptée par aucun biologiste, à
moins que cela ne soit pour des raisons philosophiques ou
religieuses).
Pour simplifier on pourrait dire que c'est Lamarck qui a
développé le transformisme puis Darwin alors que Cuvier
était fixiste (voir l'article
de Jacques Roger). Certaines personnes mal informées
confondent fixisme et créationnisme qui devrait
désigner une croyance (religieuse) selon laquelle tous les
êtres vivants ont été créés
individuellement par Dieu. Le problème est que ce dogme de la
création par Dieu ne nécessite pas d'être
appelé créationnisme, il n'a rien à voir avec
une doctrine philosophique. C'est la reconnaissance de la
dépendance absolue de chaque être vivant à chaque
instant envers son Créateur qui le maintient dans
l'être. C'est plutôt ce que l'on pourrait appelée
une création continuée. En utilisant ce
sens de "croyant en une création individuelle des êtres
vivants", on peut être créationniste et transformiste
(comme le propose actuellement l'église catholique) et
créationniste et fixiste (comme le sont quelques grouopes
protestants, notamment aux États Unis, d'après ce que
je crois savoir).
L'évolutionnisme est une doctrine philosophique dont
les sens ont été fluctuants au cours de l'histoire.
Voici par exemple deux extraits de textes
- « Le mot "évolution"
apparaît, dans la langue scientifique du XVIIIe
siècle, pour désigner, conformément à
son étymologie, le dépliement, le déploiement
du germe de l'être vivant, considéré alors
comme créé par Dieu au commencement du monde. Il
appartient donc, chez C. Bonnet par exemple, au vocabulaire du
créationnisme fixiste, et il est employé en ce sens
pendant une partie du XIXe siècle, comme son homologue
allemand Entwicklung . Le puissant mouvement historiciste qui
s'empara de la pensée européenne dans la
première moitié du XIXe siècle, en faisant
considérer l'histoire de la nature et de l'humanité
comme un «développement» graduel,
généralisa l'emploi analogique du mot. C. Lyell
(Principles of Geology , 1830-1833) parle d'évolution
en géologie, en l'opposant aux théories
«catastrophistes». On mit en parallèle
l'évolution de la surface du globe et celle du monde
vivant, déjà comparée au développement
d'un animal unique (G. Goldfuss, Grundriss der Zoologie ,
1826). Appliqué à la nature vivante ou à
l'humanité, cet évolutionnisme
généralisé suppose le plus souvent un
principe interne de développement et un progrès
général, but avoué ou sous-entendu, de
l'évolution. La doctrine de l'évolution
apparaît, avec toute sa force et sa
généralité, dans l'œuvre de Spencer, qui
emploie le mot en ce sens dès 1854, et fit plus que
personne pour le populariser, en particulier dans ses Principles
of Biology (1864-1867), où il se montrait d'ailleurs
plus proche de Lamarck que de Darwin, ce qui est facile à
comprendre. En effet, le mot evolution n'appartient pas
au vocabulaire original de Darwin. Dans De l'origine des
espèces , il n'apparaît qu'à la
sixième édition, et il y désigne beaucoup
plus un refus général du créationnisme
fixiste que le transformisme darwinien proprement dit. C'est
que Darwin se méfie des philosophes, et
singulièrement de Spencer. Il entend rester sur le seul
terrain scientifique; son originalité propre est
d'expliquer la transformation progressive des espèces par
un mécanisme qui exclut tout finalisme et tout principe
inné de développement. Son vocabulaire est donc
très neutre et descriptif: il parle de transmutation
ou de mutation des espèces, et définit
son propre système comme une theory of modification through
natural selection , une theory of descent with subsequent
modification . C'est par la suite, et au grand dépit
de Spencer, que Darwin fut considéré comme le
héraut de l'évolution. Le mot
«évolution» fait référence à
une philosophie du développement graduel et continu de la
nature et de l'humanité, animé par un principe
interne et orienté vers le progrès; le mot
«transformisme» désigne précisément
et exclusivement la théorie biologique de la transformation
et de la filiation des espèces. En ce sens, saint
Augustin est évolutionniste et non transformiste; Lamarck,
Spencer, Bergson, Teilhard de Chardin sont à la fois
évolutionnistes (comme philosophes) et transformistes
(comme savants); Darwin est transformiste et non
évolutionniste. Les biologistes contemporains, même
lorsqu'ils se disent évolutionnistes, sont en
réalité transformistes: ainsi J. Monod, qui
attaque, comme non scientifiques, les philosophies
évolutionnistes (Le Hasard et la
Nécessité ). Dans ces conditions, et
malgré l'usage établi, on peut regretter que
«transformisme», qui est univoque, disparaisse devant
«évolutionnisme», qui demeure
ambigu.» (Pour plus de détails voir
l'article de Jacques
Roger)
- « Au XVIIIe siècle, on nommait
évolution tout d'abord les phases successives par
lesquelles passe l'être vivant avant d'atteindre sa forme
parfaite; il était en quelque sorte synonyme de
développement , celui-ci couvrant
l'embryogenèse et la croissance postembryonnaire (avec ou
sans métamorphose) jusqu'à la forme adulte apte
à se reproduire. Puis, sous l'influence des
préformistes (Haller, Bonnet, Meckel,
Réaumur...), le terme évolution s'appliqua
à la théorie selon laquelle toute l'organisation de
l'être est présente dans le germe: «Le
germe préexiste à la fécondation. Toutes les
parties essentielles ont coexisté dans le même temps.
Le développement des unes paraît
précéder celui des autres. Leur consistance, leurs
proportions relatives, leur forme, leur situation subissent peu
à peu de très grands changements»
(C. Bonnet, Considérations sur les corps
organisés , t. III des Œuvres
complètes , Neuchâtel, 1779, pp. 111 et
112). Les préformistes étaient alors
qualifiés d'évolutionnistes ; on les
opposait aux épigénistes , pour qui
l'embryon se forme peu à peu à partir d'un plasma
amorphe, une modification en provoquant une autre.
Dès lors, les raisons sont évidentes pour lesquelles
le terme évolution ne pouvait venir sous la plume de
Lamarck, épigéniste convaincu, pour désigner
sa doctrine de la filiation des espèces. Pour des raisons
peu claires, Darwin laissa, lui aussi, sa doctrine
innomée.
Si ce n'est Herbert Spencer qui le premier utilisa le terme
évolution dans son sens actuel, il lui revient de l'avoir
fait connaître par ses livres dont la diffusion fut
mondiale. Thomas Huxley , le plus ardent des propagandistes du
darwinisme, utilisa très largement le terme
évolution, aujourd'hui universellement employé.
» (voir extrait plus complet
de l'article de Pierre-Paul Grassé)
Voici un essai de résumé de certaines
théories et hypothèses évolutionnistes (ce sont
souvent mes mots et non ceux de l'auteur et avec un sens moderne et
non historique, d'où à mon avis la
stérilité de telles définitions caricaturales,
mais je les donne pour essayer d'aider les candidats au CRPE):
- lamarckisme, Lamarck (1744-1829): il existe une
graduation, les organismes tendant naturellement vers une
complexité de plus en plus poussée ; le milieu
modèle l'individu ; ces modifications sont
héréditaires
- darwinisme, Darwin (1809-1882): les populations
naturelles se reproduisent en nombre excessif et subissent des
modifications dues au hasard ; un certain nombre d'individus
doivent donc être éliminés par la
sélection naturelle
- la sélection naturelle au sens moderne est une
causalité donnant une direction à l'évolution
: le milieu (pression sélective du milieu)
sélectionne les individus les plus aptes. Certains
scientifiques appliquent ce principe jusqu'aux molécules
dont l'organisation spatiale et structurelle peut-être vue
comme une adapatation-sélection. La causalité est
alors diluée dans les mécanismes physico-chimiques
décrivant le réel. On est alors vraiment dans le
cadre d'une philosophie mécaniciste, ce qui n'a plus grand
chose à voir avec le darwinisme, qui est une théorie
du vivant qui peut s'accommoder d'un vitalisme. Pour des
détails voir cours de TS , des
textes annexes sur la sélection
naturelle et surtout les textes de G. Canguilhem, notamment
le vivant et son milieu qui pose
à mon avis le vrai problème philosophique:
« Chez Darwin, on peut dire que le
finalisme est dans les mots (on lui a assez
reproché son terme de sélection) il n'est pas dans
les choses. Chez Lamarck, il y a moins finalisme que
vitalisme.»
- mutationnisme : les mutations sont le moteur de
l'évolution, le passage d'une espèce à
l'autre se fait par mutation brusque
- neutralisme : les mutations sont "neutres": elles ne se
traduisent ni par un avantage, ni par un désavantage; la
sélection naturelle ne fait qu'éliminer les
mutations les plus nocives
- dans le cadre de l'évolution "génétique"
gouvernée par les gènes (les gènes comme
support non plus uniquement de l'information
génétique (génome codant pour les
protéines) mais aussi du développement de
l'organisme (le génome comme programme
génétique) et à l'échelle des
individus, le moteur de l'évolution proposé par les
néodarwinistes est la variabilité
génétique qui peut présenter plusieurs
modalités.
- microévolution : l'évolution
génétique est progressive et lente (pratiquement
continue) notamment par des mutations au niveau des
gènes de structure
- macroévolution : l'évolution
génétique est brusque et rapide notamment par
modifications de gènes de régulation et de
développement, par des mécanismes chromosomiques
comme des translocations, duplications....
- spéciation : c'est le moteur de
l'évolution des néodarwiniens qui en font le
mécanisme de l'évolution à l'échelle
des populations. En voici un résumé caricatural :
de nouveaux individus apparaissent au sein des
populations (l'origine de la diversité se trouve dans la
variabilité génétique...). Certains sont plus
performants que d'autres (?) ce qu'ils appellent l'adaptation
(Y-a-t-il un individu qui ne soit pas adapté à son
milieu ? Non justement vous répondra-t-on, à moins
que celui-ci ne se soit déplacé ! ...). Ils sont
sélectionnés positivement (c'est la sélection
naturelle ou pression sélective du milieu) car ils se
reproduisent plus (?) ou mieux (??). Leur isolement reproductif
(barrière physique) ou géographique (du par exemple
à la dérive des continents: une ouverture
océanique par exemple...) en fait une nouvelle
espèce.
- Stephen Jay Gould, N. Eldredge,
S. M. Stanley, paléontologistes
américains, ont proposé dans les années
soixante-dix, un nouveau modèle d'évolution, dit des
«équilibres ponctués» selon lequel
l'apparition de nouvelles espèces est un
phénomène «rapide» (à
l'échelle des temps géologiques) et suivi de longues
périodes de stabilité des formes (ou
«stases») : on parle aussi d'évolution
discontinue et saltationniste (ou encore buissonnante), par
opposition à un modèle continu et gradualiste. Ce
modèle permettait de réconcilier la macro et la
microévolution qui divisaient les
généticiens. Depuis la théorie
synthétique de l'évolution préfère
parler d'évolution buissonnante.
- cladisme (méthode cladistique): c'est une
nouvelle méthode de construction d'arbres
phylogénétiques (voir cladisme dans le cours
de TS)
- néolamarckisme : le milieu modèle les
gènes et peut même provoquer l'apparition de nouveaux
gènes ; ces modifications génétiques peuvent
être héréditaires (certains
généticiens défendent cette hypothèse
et refusent une interprétation néodarwinienne de la
macroévolution)
- néodarwinisme ou théorie
synthétique de l'évolution : les mutations se
font au hasard (évolution buissonnante) et sont
triées par la sélection naturelle (pression
sélective du milieu).
Remarques personnelles:
* De nos jours, l'épistémologie moderne, dans son
effort de travail sur les obstacles épistémologiques,
recherche systématiquement des références
à ces systèmes de pensée historiques. De
nombreux didacticiens des sciences et surtout des sciences de la vie
et de la terre ce sont emparés de ces analyses et cherchent
à retrouver ces obstacles, chez les enfants du primaire. Il
n'est pas rare que dans les interprétations psychanalytiques
des productions d'enfants, on fasse appel à ce type
d'obstacles épistémologiques comme si l'enfant revivait
cette loi biogénétique fondamentale de Haeckel (voir
cours de TS) et passait successivement par
les étapes historiques du développement de la
pensée humaine sur l'évolution des espèces. Je
me demande quelle est la validité de ces analyses. Dire qu'un
enfant présente un obstacle préformiste s'il dessine un
bébé en réduction dans le spermatozoïde
paternel, relève d'un amalgame à mon sens. Il s'agit
pour moi d'une erreur due à une lacune de savoir et qui peut
être comblée par un information ad hoc. Aller rechercher
l'origine de ce dessin dans le subconscient de l'enfant relève
d'une toute autre science que la didactique de la biologie et je le
laisse volontiers à d'autres.
* Certains collègues s'escriment à faire émettre
aux enfants des hypothèses fixistes pour mieux les combattre
et leur "prouver" le transformisme (surtout en lycée).
Étant donné les connaissances variées mais
superficielles de nos enfants, et le discours médiatique sur
l'évolution très uniforme, je pense que l'on ne peut
vraiment les faire réfléchir à ces questions que
si on les aborde par le biais de l'histoire des sciences. Ceci me
semble difficile mais pas impossible au primaire. Voilà un
défi que je suis prêt à relever avec un stagiaire
que cela intéresserait.
Un essai de travail à
faire avec les enfants sur des fossiles afin de documenter
(construire ?) la notion d'évolution (ptérosaures
et premiers oiseaux....)
2.
formulations-questions-activités
par cycle
La prudence (et parfois l'indécision)
affichée dans mes formulations reflète ma conviction
que dans le domaine de cette science non expérimentale, s'il
n'est pas mauvais de raconter des histoires, il n'est peut-être
pas bon de faire croire aux enfants que c'est une histoire vraie,
même si nous en avons l'intime conviction.
|
|
cycle 1
|
cycle 2
|
cycle 3
|
|
évocations du
programme:
"au début était le rythme"
|
du rythme de l'enfant au rythme
de la vie :
naissance, croissance, mort
présent-passé -futur
(une prise de conscience du futur
comme attente, projet,
souhait...)
|
du rythme de la vie au rythme de la
terre (écosystème)
les saisons et les rythmes de vie des êtres
vivants
présent-passé-futur
(l'enfant se situe dans le
passé et le futur proches, et progressivement, par
rapport à un passé et à un futur plus
lointains)
|
du rythme de la terre au rythme de
l'univers (du temps abstrait au temps concret)
traces de l'évolution des êtres
vivants
|
|
division sociale et naturelle du temps
abstrait
(jour-semaine-mois-année-calendrier-agenda)
approche de l'histoire: la famille du passé
(généalogie) et le patrimoine (histoire des
hommes), témoignages
|
mouvement apparent du soleil et rotation
de la terre
mesure du temps (clepsydre, cadran solaire, appareils
mécaniques, utilisation d'appareils
électroniques)
succession chronologique des événements de
l'histoire de France replacés dans l'histoire de
l'Europe et du monde
|
|
le temps d'avant l'histoire
|
Certaines histoires sont vraies car elles ont vraiment eu
lieu par le passé. D'autres histoires sont des
rêves ou des histoires imaginées qui n'ont
jamais eu lieu.
Ce qui nous aide à savoir si une histoire est
vraie ou non est d'abord la connaissance de la personne qui
nous la raconte (on peut lui faire confiance ou ne pas lui
faire confiance).
|
L'histoire, période et science, commence
avec l'apparition de l'écriture. La
préhistoire* est le temps et la science de
l'homme d'avant l'histoire.
La paléontologie est la science qui
étudie les êtres vivants du passé. La
paléoécologie est la science qui
étudie les écosystèmes du
passé.
|
|
Personne ne peut dire: j'ai créé la
vie.
Comme tous les êtres vivants, l'homme vient à
la vie par d'autres êtres vivants (parents). On
imagine donc une chaîne ininterrompue d'êtres
vivants des plus vieux (ou premiers ?) organismes aux
êtres vivants actuels.
La vie vient d'avant l'homme : des êtres vivants
vivaient probablement avant l'homme.
|
L'homme a probablement existé avant
d'écrire (il peut parler et faire, ce qui peut lui
suffire pour montrer et donc transmettre à ses
enfants ce qu'il est et ce qu'il a: sa culture): il y a donc
probablement eu des hommes préhistoriques.
Comment savoir qu'un squelette ancien ou un outil
appartenait à un homme préhistorique ? On a
des indices, on peut en avoir la conviction mais il ne peut
pas y avoir de preuve scientifique, expérimentale,
testable (par une expérience). La préhistoire
est une science de l'homme qui utilise les sciences
expérimentales mais qui n'est pas
expérimentale par sa méthode (on ne fait pas
d'expériences sur des phénomènes
passés) : il n'y a donc pas de
vérité scientifique expérimentale (pour
laquelle tous les scientifiques seraient d'accord) dans le
domaine de la préhistoire.
|
|
Existait-il quelque chose avant la vie ? Les physiciens
spécialistes de l'univers (astrophysiciens) ont
construit des modèles qui font remonter la formation
de la terre à 4,5 milliards d'années à
partir d'un nuage de poussières qui se collent les
unes aux autres. Pour eux, la vie n'apparaîtrait que
vers 3,5 milliards d'années, une fois
déposée la couche d'eau des océans
à la surface de la planète refroidie. Tous les
scénarios présentés ne sont que des
histoires qui n'engagent que leur auteur.
|
|
Etude de
récits** de l'origine du monde :
contes traditionnels de divers peuples, livre de la
Genèse (une histoire, une date plus ou moins
précise, un peuple).
|
|
Comment dater une roche plus ancienne que l'homme
?
Les scientifiques utilisent deux sortes de méthodes :
des méthodes logiques (qui comparent des roches entre
elles) et des méthodes expérimentales (voir
formulation ci-dessus)
qui permettent de donner un âge (possible mais jamais
certain) avec plus ou moins de précision.
|
|
Un fossile est la trace ou les restes
conservés d'un être vivant mort il y a
très longtemps.
Les impressionnants squelettes de dinosaures
reconstitués dans les musées attestent de la
vérité historique des formes de vies disparues
actuellement. C'est le travail des
paléontologues (paléoécologistes) que
d'essayer de dater les fossiles le plus
précisément possible et de retrouver tous les
indices nous permettant de comprendre comment vivaient les
organismes du passé ayant laissé ces fossiles.
Leur principal travail est d'établir des comparaisons
avec les organismes vivants actuellement.
|
La fossilisation c'est la transformation d'un
être vivant mort ou de sa trace (empreinte...) en
fossile.
|
|
Les cadavres actuellement se trouvent dans (ou sur) le
sol ou dans (ou sur) les sédiments (des lacs ou des
mers). On trouve donc des fossiles surtout dans les roches
sédimentaires, formées à partir des
sédiments. Les fossiles sont rares dans les roches
sédimentaires et extrêmement rares dans les
roches métamorphiques et on n'en trouve jamais dans
les roches magmatiques. La matière organique des
cadavres ne se retrouve pas dans le fossile (lorsqu'il y a
beaucoup de matière organique dans un
sédiment, elle peut s'accumuler et donner des roches
carbonées (voir
roches). Mais l'empreinte
des parties molles peut rester après départ de
la matière organique. Les structures du cadavre de
l'être vivant peuvent aussi être
remplacées par des éléments
minéraux et devenir petit à petit de plus en
plus dures et être ainsi conservées (c'est
l'épigénie: remplacement d'un minéral
par un autre; mais ce peut-être aussi une simple
recristallisation d'une partie déjà
minérale comme une coquille ou un os). Dans certains
cas, toute trace directe de l'être vivant à
disparu et l'on n'observe que son moulage qui s'est
fossilisé.
Des cadavres complets de mammouths conservés dans
la glace ou d'insectes conservés dans l'ambre
(résine) sont des cas rares de conservation sans
réelle fossilisation.
|
|
Les plus vieilles formes que certains
paléontologues pensent actuellement être des
fossiles sont de minuscules bâtonnets qui apparaissent
en relief dans des roches très dures (schistes) et
qui rappellent des bactéries actuelles
(bactéries bleues). Ils sont datées de
plus de 1,5 milliards d'années.
Les plus vieux fossiles incontestables sont plus gros et
ressemblent un peu à des insectes ; ils sont
datés de quelques 500 millions d'années.
|
|
Au primaire
l'intérêt n'est pas, à mon sens,
d'étudier des concepts et des théories, mais
bien de donner cette envie d'étudier et de comprendre
le réel: il faut donc partir des fossiles et
d'activités qui peuvent aider à comprendre la
fossilisation. Disposer de matériel
récolté dans la région est bien
sûr
l'idéal.
- des fossiles, de toutes les couleurs, de toutes
sortes de roches (grès, schistes, calcaires
coquilliers, silex taillés...): pour chacun donner
son âge estimé
(le replacer dans une
frise chronologique affichée... Tavernier p
371), la roche dont il est
extrait et donc le sédiment d'où il est issu
et par là, approcher son milieu de vie, replacer
l'organisme vivant qu'il rappelle dans la classification des
organismes actuels
(faire des
comparaisons entre ce que l'on trouve à partir de la
roche et ce que l'on trouve à partir de la
classification);
- de l'argile (magasins de fournitures artistiques)
et des restes d'êtres vivants de toutes sortes
(feuilles, rameaux, coquilles, mousses...) afin de faire
comprendre la notion d'empreinte, de moule interne et
externe (quelques fossiles présentant ces moules
seraient aussi bienvenus).
|
|
la formidable hypothèse
|
L'évolutionnisme ou transformisme
est une théorie (une grande hypothèse) selon
laquelle tous les êtres vivants actuels proviennent
d'êtres vivants anciens peu nombreux et ayant disparu
actuellement (ancêtres), qui se seraient
diversifiés. L'évolution biologique
c'est l'histoire des êtres vivants sur la terre.
|
|
la préhistoire*
|
Aucune connaissance
exigible là encore mais peut-être faire
naître ou favoriser cet enthousiasme pour les premiers
outils ou les premières peintures rupestres; par
contre un travail sur des moulages de crânes ou sur
des dessins de squelette n'est à mon avis pas
adapté au primaire
:
- documents sur des mégalithes : reconstitutions avec
des maquettes et des textes explicatifs
suggérant leur histoire
- documents de peintures rupestres : réalisation d'un
atelier de peinture sur paroi recouverte de sable
collé avec des pigments naturels, recherche des
formes épurées...
- outils préhistoriques et atelier de taille de
silex
(précautions
particulières du fait du danger des éclats et
éviter de laisser ensuite ces "faux" dans la
nature), ou réalisation
de haches ou lances et faisant une étude sur les
ligatures (actuellement les ouvrages de préhistoire
regorgent d'études très sérieuses
réalisées en dimension réelle et on est
surpris de l'ingéniosité des
montages...).
|
|
* la protohistoire recouvre la
connaissance des hommes sans écriture contemporains
des premiers hommes avec écriture. Certains y voient
une période de transition, d'autres une
juxtaposition.
** Le but étant de
s'affranchir de l'idée selon laquelle ces
récits ne sont que des
contes et que la vérité
vient des résultats de la science. C'est le
sens de ces récits qui fonde
leur différence: ce n'est pas un problème de
vérité scientifique: on ne peut pas dire "cela
s'est passé comme cela" (puisque personne ne peut
affirmer atteindre cette vérité
expérimentale à laquelle le scientifique est
si attaché) mais bien un problème de message:
qu'est-ce que telle ou telle société
traditionnelle véhicule dans ces récits ?
Qu'est-ce que les paléontologues et les
astrophysiciens apportent à notre vision du
l'histoire du monde ? (Il faut oser répondre qu'ils
n'apportent pas la vérité scientifique, qu'il
n'y a pas de vérité scientifique
expérimentale pour le passé).
|
concepts (de l'objet à la
méthode / l'actualisme /
les datations / l'évolution
des êtres vivants), formulations-questions-activités
par cycle
retour accueil