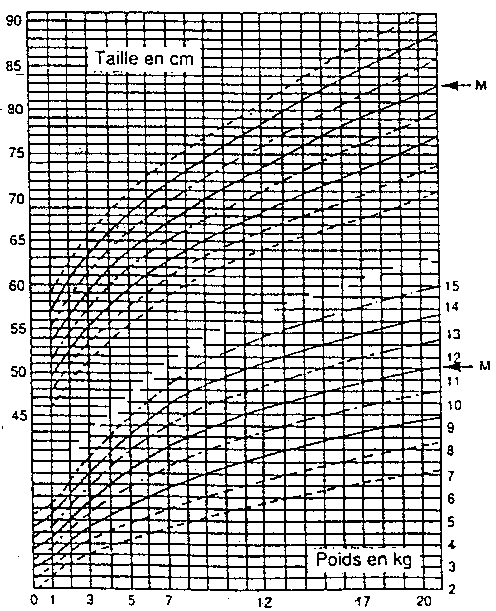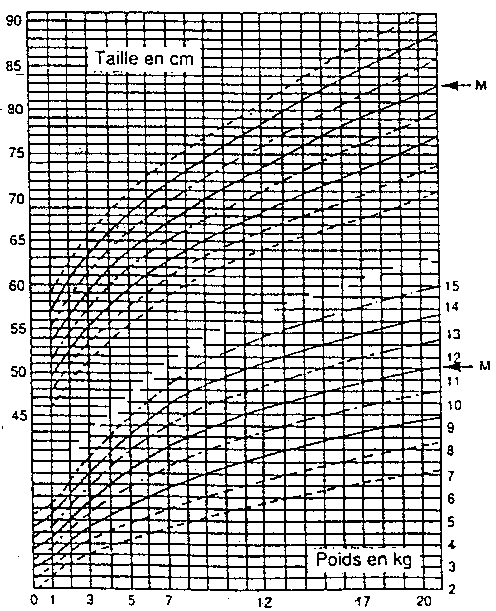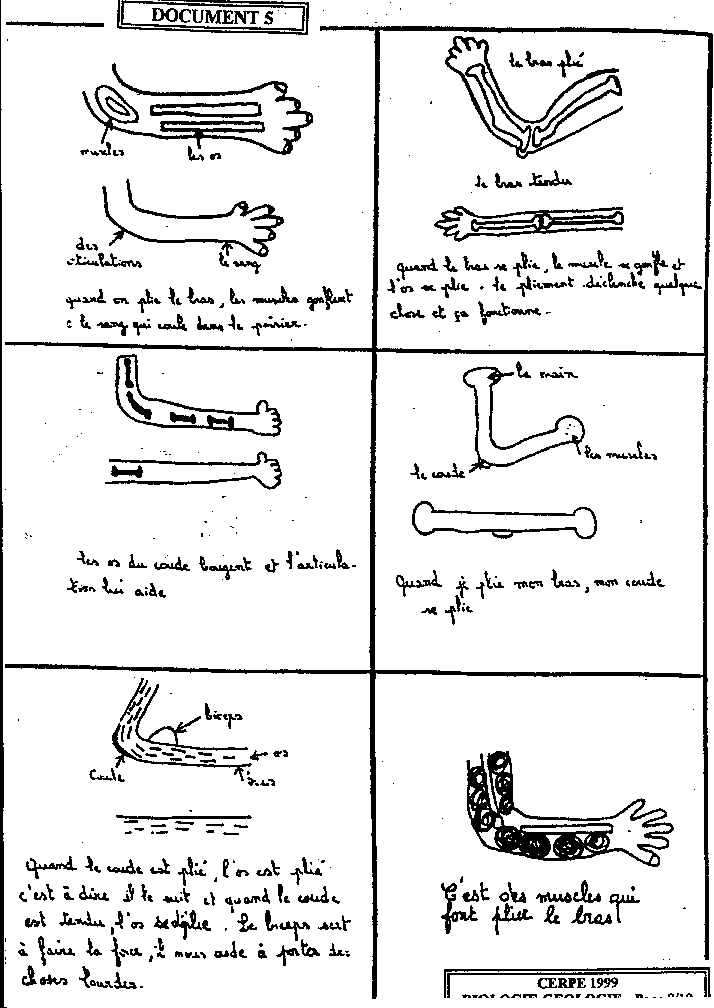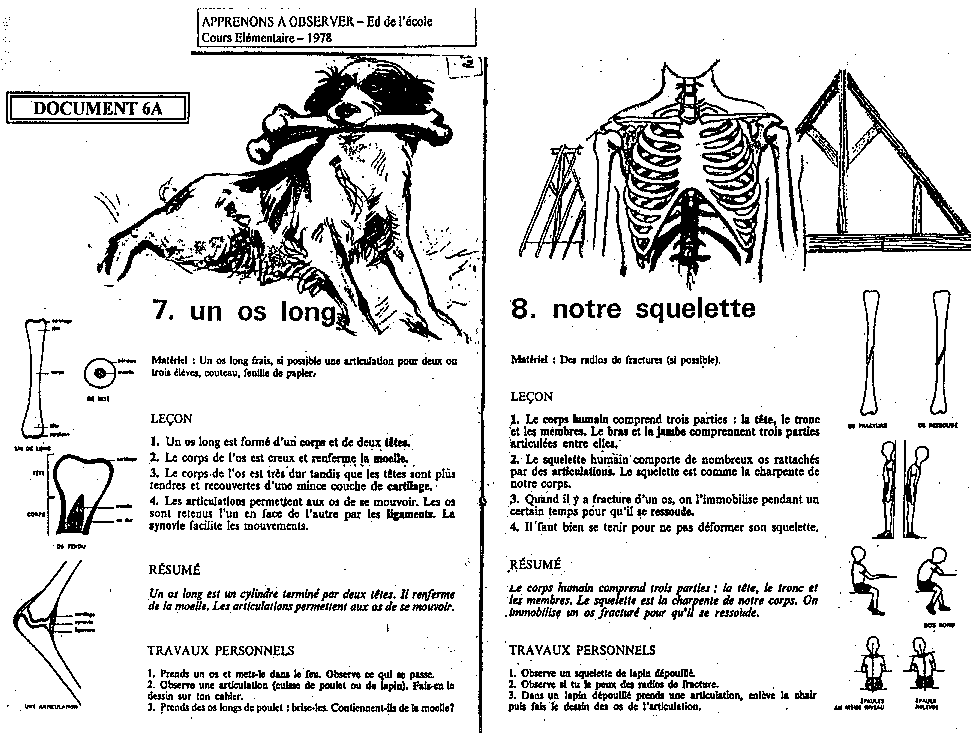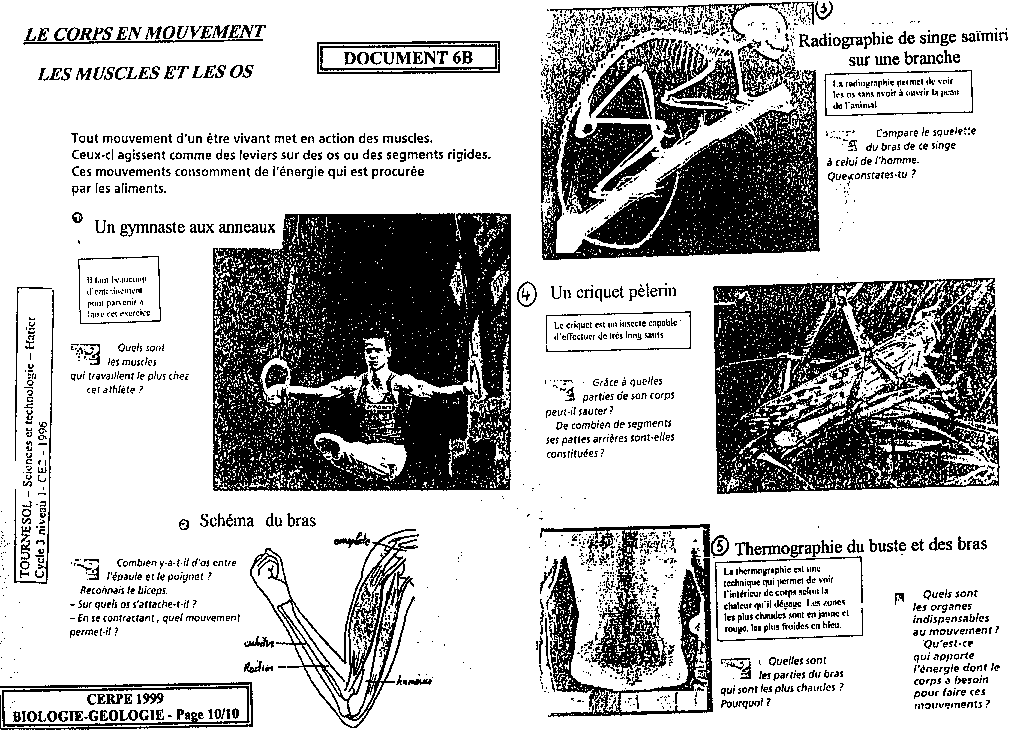|
1 - a) je
recopie un document distribué par Henri Le Gal,
formateur de SVT à Vannes:
|
Les
intérêts pour les enfants et pour le
maître de commencer des activités par
le questionnement du savoir
préalable des enfants.
|
|
Le recueil des conceptions
initiales permet aux enfants de :
|
Le recueil des conceptions
initiales permet au maître de :
|
- faire le point sur ce
qu'ils savent ;
- dédramatiser
leurs erreurs ;
- prendre l'habitude de
s'exprimer sur ce qu'ils pensent ;
- se rendre compte de
leurs limites.
|
- connaître le
niveau réel de ses élèves ;
- repérer les
principaux obstacles rencontrés par eux ;
- définir les
objectifs-obstacles qu'ils va ensuite tenter de
surmonter avec ses élèves ;
- d'adapter ses
objectifs au niveau réel des enfants.
|
j'ajoute que d'une façon très
générale ce type de début de
séance permet à l'enfant de s'approprier
le sujet: les efforts de représentation qu'il
fait débouchent effectivement sur une
situation-problème ou situation déclenchante.
Pour essayer d'être plus complet que ce que la
question nous autorisait à dire, il faut aussi citer
:
les
inconvénients de
commencer des activités par le
questionnement du savoir préalable des
enfants
(ou recueil des représentations ou
conceptions initiales)
|
|
pour
l'enfant
|
pour le
maître
|
- déflorer le
sujet, si bien qu'après la séance
de dessin, on observe une certaine
démobilisation
- fixer les
erreurs
|
- ce travail de
psychanalyse des productions graphiques (ou des
échanges verbaux) n'est pas à la
portée de n'importe qui;
concrètement il me semble parfois
très difficile, voire insurmontable, de
débrouiller les causes multiples des
"erreurs" ou "omissions" des enfants:
déficience artistique ou de vocabulaire
de l'enfant, peur ou honte à
représenter ce qu'il pense,
méconnaissance, non compréhension
de la question (dessine l'intérieur de
ton bras signifie-t-il par exemple la
totalité du bras, de l'avant-bras et de
la main ?)....
- ce travail demande
beaucoup de TEMPS
- ce travail ne peut se
faire seul, il doit déboucher sur des
apprentissages spécifiques en fonction
des obstacles repérés ce qui
implique UNE et UNE SEULE PÉDAGOGIE...
Choisir une autre entrée: démarrer
la séance par un film, une sortie, un
élevage, des expériences.... peut
amener à plus de
liberté...
- il est d'usage de
faire une deuxième séance de
recueil de représentation après
l'apprentissage, par exemple comme
évaluation sommative... ce qui augmente
encore le temps nécessaire pour cette
méthode
|
:
1 - b) sans trop insister sur la
consigne : "dessiner les os" (on ne peut donc pas attendre
autre chose que le squelette : ni les muscles et encore moi
l'appareil circulatoire...) et "bras" pris au sens courant
et non anatomique d'élément proximal du membre
antérieur (par opposition à l'avant-bras).
Les éléments à soulever sont : les
relations entre les muscles et les os (tendons); les
relations entre les os (articulations) et surtout leur
mouvement relatif qui dépend aussi du nombre d'os de
chaque membre; éventuellement le rôle des
muscles ; éventuellement aussi le rôle de
l'appareil circulatoire.
1 - c) en cycle 3 : squelette (os et articulations), muscles
(et tendons) et système nerveux ainsi que le travail
de nutrition (voir cours "je
peux bouger").
2 - a)
|
|
1978
|
1996
|
|
documents
utilisés
|
os frais, squelette de
lapin, os de poulet
radios
schémas
silhouettes-pantins
illustrations (dessins)
textes rédigés
|
photos,
schémas,
radiographie
thermographie
quelques petites phrases
|
|
activités des
élèves
|
observer le réel,
manipuler- expérimenter (hypothèse -
observation guidée - conclusion), dessiner,
faire une synthèse (écrire,
réfléchir...)
|
répondre à
des questions, écrire, observer des
documents
|
|
contenus
scientifiques
|
forme, structure,
caractéristique du vivant des os
(morphologie, anatomie, physio-histologie)
articulation et ligaments
squelette: rôles, notion d'hygiène
(bonne position....)
|
leviers (???) muscles
vivants (énergie, irrigation),
nombreux concepts
scientifiques sous-jacents mal ou non
exprimés : squelette,
articulation,
écologie :
adaptation au saut (transposition homme - criquet
pas évidente) et à la vie
arboricole
|
|
place de chaque (document,
élément du manuel ???) dans la
progression
|
au choix du maître :
alterner les activités pratiques et la
rédaction de la synthèse (à
apprendre )
|
id. on peut proposer
l'ordre suivant : 1, 3, 2, 5 et 4
|
|
Certains PE proposent
pour cette dernière ligne une
interprétation de la question dans un sens
historique: quelle pédagogie,
historiquement, était alors couramment
répandue avec le manuel de 1978...et quelle
pédagogie est-elle encouragée avec le
nouveau manuel. Cette interprétation est
possible mais il faut alors que la réponse
indique clairement dans quelle perspective l'on se
place.
|
b) le manuel de 1978 est un
manuel pratique , outil pour le maître aussi bien
que pour l'élève. Le manuel de 1996 est
un outil documentaire pour l'élève.
Mais surtout ce ne sont pas les mêmes sujets qui sont
traités : le manuel de 1978 traite des os (squelette)
et de leurs rôles alors que la page du manuel de 1996
a pour sujet les mouvements, les éléments
nécessaires et leurs variations : le sujet est
à la fois nettement plus ambitieux (ouverture
écologique notamment) et superficiellement
abordé puisque le nombre de documents est très
limité en face des concepts abordés.
Il me paraît essentiel de ne pas véhiculer
une vision réductionniste de l'utilisation des
manuels en présentant le manuel ancien comme un outil
pour le maître qui transmet le savoir à
l'enfant qui reste passif (c'est bien tout le contraire qui
apparaît si l'on prend soin de détailler les
nombreuses activités proposées à
l'élève); de la même façon, le
manuel moderne n'est à lui seul en aucun cas une
garantie de la construction du savoir de l'enfant, par
lui-même, comme le voudrait une certaine
pédagogie politicienne. Le manuel moderne est un
outil, aussi bien pour le maître que pour
l'élève et la pédagogie sera ce que le
maître en fera, ce que les élèves
l'aideront ou l'empêcheront de
faire....
|
Les manuels scolaires:
quelques notes à partir
de l'article "manuel scolaire" du Dictionnaire
de pédagogie, Louis Arénilla,
Bernard Gossot, Marie-Claire Rolland et
Marie-Pierre Roussel, Bordas, 2000
|
|
Du point de vue étymologique, manuel
signifie un ouvrage que l'on a toujours "en
main".
Le premier manuel est attribué à
Comenius en 1633: un manuel d'apprentissage de la
langue maternelle.
En 1833 la loi Guizot autorise un choix "libre" au
sein de la liste des ouvrages autorisés, les
inspecteurs veillant à ce qu'il ne soit fait
usage dans les écoles publiques que de
manuels autorisés par le Conseil royal.
(Mais il semble qu'il y ai eu de constantes
infractions).
En 1850, la loi Falloux étend le véto
qui touchait les seuls établissements
privés aux établissements secondaires
publics.
A partir de 1876, avec Jules Ferry, la
liberté devient totale, les inspecteurs et
recteurs réunissant cependant les
maîtres pour éclairer leurs avis et
motiver leurs choix.
Actuellement donc la liberté est totale du
point de vue morale. Les choix sont parfois
guidés par des impératifs
économiques (il existe une liberté
commerciale totale pour les éditeurs). Les
avis des inspecteurs sont des recommandations qui
ne peuvent aboutir ni à une recommandation
officielle, ni à une interdiction.
On reproche parfois aux manuels:
* une trop grande directivité, qui est
contrebalancée par une forte
cohérence
* un dépassement du cadre des programmes et
un double-emploi avec le cours, deux
éléments qui dépendent bien
évidemment du type de pédagogie mis
en place par le maître: le manuel
étant cependant avant tout un outil de
travail en commun pour les élèves (ce
qui évite aussi les excès de
photocopies...), on ajoutera aussi que la
matérialité du livre favorise la
mémorisation et l'assimilation
* une idéologie, rarement franchement
avouée.
L'article se termine en prédisant une
confortable espérance de vie aux manuels par
rapport aux CDRom et autres cartables virtuels.
|
|
De l'usage
pédagogique du manuel scolaire et autres
supports-papier en sciences
expérimentales
|
|
Le manuel scolaire moderne n'est pas un guide
pour le maître (type Tavernier) ni un cahier
ou fichier d'activités, c'est bien un manuel
POUR l'ÉLÈVE.
Voici ce qu'en disent Maryline Cantor et al.
dans De la découverte du monde
à la biologie aux cycles II et III,
Nathan, 1996
|
Le manuel
scolaire
choisir un manuel adapté
|
Le cahier et les fiches
d'activité
Des fiches pour une pédagogie
différenciée
|
|
Le manuel scolaire est
un ouvrage destiné à
l'élève. Les manuels
scolaires sont variés et peuvent
refléter des conceptions
différentes dans les modèles
d'apprentissage.
Ils permettent de
mettre entre les mains de tous les enfants
de la classe des documents variés :
des documents déclencheurs pour
susciter un questionnement ou faire
émerger des conceptions initiales,
des iconographies, des informations
directes ou sous forme de banques de
données (textes, schémas,
illustrations, etc.)
Dans une
démarche constructiviste,
plutôt que de transmettre
directement des savoirs, le manuel a pour
fonction de susciter la curiosité
et le questionnement, faciliter les
apprentissages en sollicitant les
investigations et en permettant des
confrontations à des informations.
D'autres
éléments doivent
également être pris en compte
pour choisir un manuel ; qualité de
l'iconographie, lisibilité,
présentation, présence d'un
lexique, etc.
|
Ces fiches ne doivent
pas constituer de simples exercices mais,
dans la mesure du possible, faciliter une
réelle mise en activité des
élèves (exemple : voir
document page 75).
La fiche
d'activité prend toute sa
signification dans le travail
individualisé : l'enfant peut
suivre des consignes, s'organiser et
trouver des solutions en respectant son
propre rythme.
Le maître ne doit
cependant pas verser dans l'excès
d'une utilisation systématique de
fiches (en général
polycopiées) car elles ne
permettent pas à
l'élève de résoudre
de façon concrète bon nombre
de problèmes scientifiques et
bloquent toute démarche
créatrice.
La fiche
d'activité est pertinente lorsque
le problème à
résoudre et les solutions
envisagées sont définies
auparavant et lorsqu'elle répond
à un besoin précis des
enfants à un moment donné de
la démarche.
|
Voici 3 exemples modernes à discuter en
reprenant l'exemple du squelette, des muscles et du
mouvement:
|
Une encyclopédie pour le cycle 3
(voir
préface*)
|
Sciences et technologie, cycle 3
(CE2, CM1, CM2), Jack Guichard et Brigitte
Zana, Les Savoirs de l'école,
Collection dirigée par Jean
Hébrard, 1999, Hachette
Éducation
|
Le squelette en mouvement, p 42-43
Des muscles et des os pour bouger,
p44-45
|
|
un manuel-fichier ressources
(enseignant); deux fichiers
d'expériences
(élèves)
|
Le Moniteur des sciences,
Bernadette Bornancin, cycle 3, "le
monde vivant", niveaux 1, 2 et 3,
(fichiers d'expériences 1 et 2 et
fichier ressources), Nathan, 1998
|
Comment le corps tient-il debout et
comment bouge-t-il ? (p 31-32)
Prendre conscience que le corps tient
debout sur ses deux pieds (p 33-34)
Observer la diversité des
mouvements possibles du corps
dressé à la verticale (p
35-36)
Fichier d'expérience 1, Fiche 3,
Les os et les muscles
|
|
un manuel élèves
|
Science et technologie, CM,
collection Tavernier, Bordas, 1997
|
Comment ton corps peut-il bouger ? p
34-35
Des muscles à ton service, p
36-37
|
*
Préface
C'est maintenant une évidence pour beaucoup
d'enseignants : le manuel scolaire est un
instrument que l'élève de cycle III
doit absolument s'approprier avant de quitter
l'école primaire de manière à
en avoir un usage efficace et déjà
relativement autonome lorsqu'il rejoint le
collège.
Or, pour que l'enfant puisse apprendre à se
servir des outils qui sont à sa disposition,
il est nécessaire que ces outils se
présentent à lui d'une manière
claire et lisible. Dans beaucoup de manuels, il est
difficile de distinguer ce qui relève des
indications didactiques données aux
maîtres, des dispositifs d'exploration de
notions, des exercices ou des synthèses
élaborées une fois les connaissances
construites, des informations données
à l'élève. Cela est d'autant
plus délicat dans le domaine des sciences
que l'on attend à juste titre que l'enfant
agisse plutôt qu'il ne lise. Dans la
perspective des dernières innovations
didactiques - bien connues maintenant sous la
dénomination de « La Main à la
pâte » -, on a donné une place
mieux définie à l'écrit dans
le processus de construction des savoirs et savoir
faire scientifiques. L'écrit intervient, en
effet, d'une part pour l'information des
enseignants (information scientifique et
méthodologique), d'autre part dans les
protocoles d'expérimentation soumis à
l'attention des élèves (sans pour
autant bloquer leur initiative propre), dans la
notation des informations recueillies au cours de
l'expérience ou de l'observation, enfin dans
la rédaction de l'aventure scientifique qui
a été vécue.
Ce sont ces différents aspects de la
relation d'une première initiation à
la pensée scientifique avec la
capacité de lire et de rédiger qui
ont été pensés ici par l'une
des meilleures équipes de didacticiens qu'il
soit possible d'imaginer dans ce domaine. Cela
donne aux instruments traditionnels de toute
méthodologie contemporaine (livre du
maître, cahiers ou fiches d'exercices,
manuel) une dimension radicalement nouvelle. Les
auteurs ont aussi apporté à
l'entreprise un aspect qui, à mes yeux, est
certainement irremplaçable. Si faire des
sciences c'est observer et expérimenter,
faire des sciences c'est aussi lire des sciences.
Aucun scientifique ne le démentira. Ils
proposent donc aux enfants de sans cesse ramener
leurs notations prises sur le vif aux connaissances
qui ont été mises à leur
portée dans le précis des Savoirs de
l'école.
Véritable petite encyclopédie, ce
livre est le répondant direct des
activités subtiles et passionnantes
proposées dans le fichier et soutenues par
tout un appareil scientifique et didactique dans la
partie réservée au maître. Dans
les trois années du cycle III, les
maîtres pourront parcourir à leur aise
(plusieurs cheminements sont possibles) cet
ensemble très complet qui est ainsi mis
à leur disposition. D'une certaine
manière, on relie ici les savoirs les plus
contemporains à l'esprit de vulgarisation
qui avait prévalu lors de la première
révolution scientifique, celle du XIXe
siècle, et dont la fameuse «
leçon de choses » était
restée l'emblème. On avait longtemps
utilisé ce terme pour l'opposer à
l'esprit novateur des années 1970.
Il est clair que Brigitte Zana et Jack Guichard ont
su admirablement dénouer cette
équivoque et jouer avec brio leur partie
dans cette aventure collective que sont devenus Les
Savoirs de l'école.
Jean Hébrard
(retour
tableau)
|
|